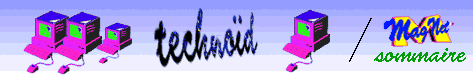

L'ozone tiraillée entre environnement et développement

|
14-12-95 - La conférence internationale de Vienne, close le 7 décembre, a établi un nouveau calendrier de réduction des émissions de substances nocives à la couche d'ozone. Cela n'a pas été sans heurts : les pays en voie de développement se sont opposés à des mesures trop sévères, car leur économie en pâtirait.
Le constat a beau être unanime, agir en conséquence ne l'est pas autant. La couche d'ozone se détériore de plus en plus. Or les quelque 120 ministres présents à la conférence internationale sur l'ozone, à Vienne, du 5 au 7 décembre, ont longtemps tergiversé pour renforcer les mesures de protection. L'ozone, présente sur une faible épaisseur dans l'atmosphère, arrête certains rayons ultraviolets du soleil qui seraient nocifs pour les espèces vivantes. Or elle est attaquée par divers autres gaz industriels. Les plus connus sont les chlorofluorocarbones (CFC), les halons ou les tétrachlorures de carbone. Ils entrent par exemple dans la composition des aérosols, des gaz réfrigérants, des mousses de protection d'emballage ou encore des produits de nettoyage des composants électroniques. Trou géantPar une réaction chimique, ils détruisent les molécules d'ozone (03), lors de leur migration vers les plus hautes strates de l'atmosphère. Résultat : la couche est amincie. La brèche la plus spectaculaire se trouve à la verticale de l'Antarctique, sur une surface équivalente à celle du continent européen... Un trou deux fois plus large que celui détecté en 93. Un limitation des émissions s'imposait : c'était l'objet du Protocole de Montréal, signé en 1987. Cet accord, ratifié par 149 pays, établit un calendrier de réduction des émissions et des dates-butoir au-delà desquelles toute production ou utilisation de certaines substances sera interdite. Par exemple, les CFC seront totalement interdits au 1er janvier prochain dans les pays industrialisés. Pour les pays en voie de développement (PVD), l'interdiction s'appliquera en 2010. |
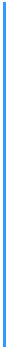 |
Fichu bromure
Echappe encore à la réglementation établie par ce protocole un gaz naturel, le bromure de méthyle, objet de toutes les critiques de la part des pays riches car extrêment nocif pour l'ozone. La conférence de Vienne vient de décider que dans les pays riches, son usage sera interdit en 2010, après une réductionde 25 % en 2001 et de moitié en 2005. Au grand regret des «riches», le calendrier n'a pas été étendu aux PVD, pour tenir compte des contrecoups économiques qu'ils auraient eu à subir : le bromure de méthyle est utilisé en effet comme pesticide par les paysans. Ainsi, à Vienne, l'Inde ou le Kenya ont affirmé que trop de sévérité «tuerait (leur) agriculture». Finalement, les ministres ont décidé que les PVD gèleraient leur consommation de ce produit en 2002, sur les bases d'un moyenne 95-98. DilemmeCe hic sur le bromure de méthyle illustre le dilemme qui existe de façon flagrante entre environnement et développement. Miser sur le premier est indispensable. Et payant : ainsi, de 1986 à 1993, la production de CFC dans le monde est passée de 1,2 million de tonnes à 700 000. Mais les PVD estiment qu'on sacrifie leur économie sur l'autel écologique. Alors ils prêchent la modération, voire contournent la réglementation. Parfois avec le concours des riches : ainsi, les CFC font déjà l'objet d'un vaste trafic international, depuis les pays industrialisés et vers les PVD consommateurs. Tout serait parfait si les gaz de substitution aux produits incriminés étaient irréprochables. Or eux aussi sont nocifs ! Les hydrofluorocarbones (HCFC), qui remplacent certains CFC, font eux-mêmes l'objet d'une réglementation ! Dès lors, les PVD n'ont plus qu'à évoquer ces arguments pour faire triompher leur cause. Le dilemme est patent ; la difficulté avec laquelle a été trouvé le compromis de Vienne l'illustre aujourd'hui. 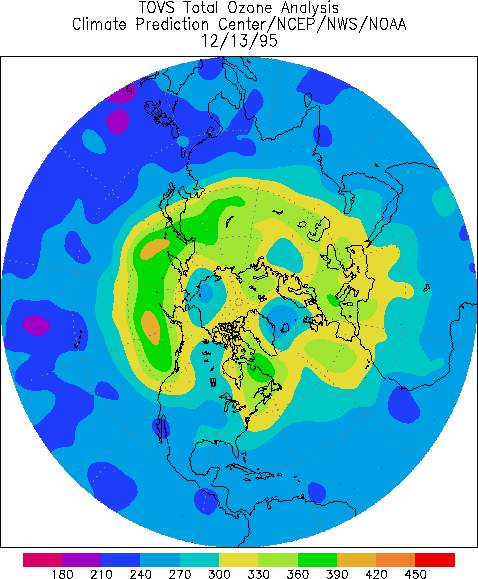
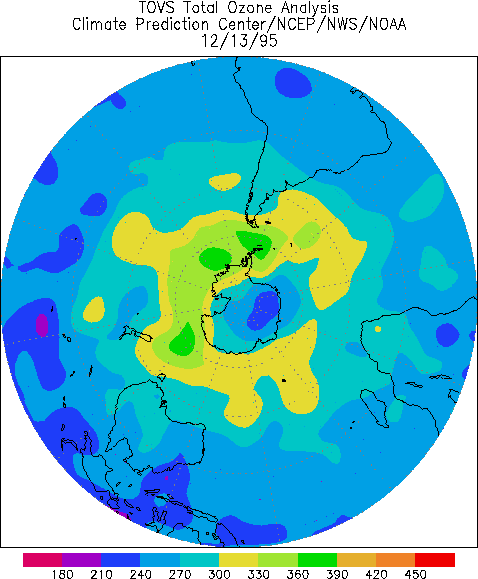
|
Le Comité de conjoncture éco-industriel, qui s'est vient de se réunir au ministère de l'Environnement, table sur une croissance des éco-industries de 4 % l'an prochain, contre 3 % cette année. Les investissements dans le domaine de l'environnement, principalement l'eau et les déchets, avaient baissé de 5 % en 1994, cru de 8 % en 1995, et devraient augmenter de 11 % en 1996. Ces chiffres sont moins élévés que ceux fixés par des études antérieures. Le développement des éco-industries a souffert du fait que l'année 1995 coïncidait avec les élections municipales : les commandes des collectivités locales en matière d'environnement ont été moins nombreuses cette année. Le ministère a appelé a favoriser la croissance, qui devra s'accompagner «d'une recherche forte de gains de productivité et d'une limitation de la hausse des prix». L'activité des éco-industries a atteint 125 milliards de francs en 1994.
Guillaume Maincent